La proposition de classification harmonisée de l’Allemagne ainsi que la proposition d’avis de l’EFSA (agence européenne de sécurité alimentaire) sur l’établissement de la Dose Journalière Admissible (DJA) ont toutes les deux faits l’objet de consultations publiques récentes auxquelles Générations Futures a participé (1). Les nouvelles données disponibles, confirment la toxicité du TFA pour le développement du fœtus et révèlent de nouveaux points d’alerte. Cependant, de nombreuses incertitudes sur la toxicité de cette substance à laquelle nous sommes tous quotidiennement exposés persistent. En conséquence, une approche prudente, basée sur le principe de précaution doit s’appliquer pour l’établissement de la dose journalière admissible. Générations Futures dénoncent la méthode utilisée par l’EFSA qui propose une DJA non suffisamment protectrice.
Le TFA : une substance PFAS omniprésente et persistante
Le TFA est une substance PFAS d’une persistante extrême. Non réglementées à ce jour, les sources d’émission de TFA dans l’environnement sont nombreuses et diffuses: il est en effet un produit de dégradation d’autres substances PFAS, notamment des gaz fluorés et des pesticides PFAS. L’usage croissant de ces substances depuis une vingtaine d’années explique l’augmentation alarmante des concentrations en TFA dans tous les milieux (eau, sol, végétaux etc.). En conséquence de cette contamination généralisée de l’environnement par le TFA, nous sommes tous exposés quotidiennement à cette substance que ce soit par l’alimentation ou par l’eau potable. En janvier 2025, Générations Futures et l’UFC Que Choisir avaient montré la présence importante de TFA dans l’eau potable en France. L’Anses devrait bientôt publier les résultats de sa campagne d’analyses exploratoires des PFAS dans l’eau potable, analyses qui incluent le TFA et qui viendront très probablement confirmer nos résultats.
Le constat de la présence généralisée de TFA dans l’environnement et l’eau potable étant maintenant bien établi, le principal enjeu pour les pouvoirs publics est désormais de savoir si le TFA est toxique, et surtout à partir de quel niveau d’exposition ses effets toxiques peuvent apparaître. Ainsi, une proposition de classification est à l’étude au niveau européen auprès de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA). l’EFSA, l’agence européenne de sécurité des aliments, a également été saisie pour évaluer le TFA est proposer une Dose Journalière Admissible, c’est-à-dire dire la dose maximale que l’on peut absorber chaque jour sans risque pour la santé. Ces deux propositions ont été soumises à la consultation du public. La consultation sur l’avis de l’EFSA s’est achevée ce lundi 22 septembre.
La reprotoxicité du TFA reconnue par tous les Etats Membres ayant participé à la consultation publique
Le principal enseignement de ces 2 avis est clair: le TFA est une substance reprotoxique susceptible de nuire au développement du fœtus. L’Allemagne avait en effet proposé à l’ECHA de classer le TFA en tant que reprotoxique de catégorie 1B. Tous les Etats Membres, dont la France, ayant participé à la consultation publique soutiennent cette proposition de classification. Les résultats de 2 études réalisées en 2021 et 2024 sur des lapins sont sans appel : dans ces 2 études, les lapins exposés in utéro au TFA présentent des malformations importantes des yeux, au niveau de la rétine. Les tentatives de l’industrie pour démontrer que ces effets ne seraient pas pertinents pour l’homme ont été vaines.
Des effets toxiques bien plus larges mis au jour dans l’avis de l’EFSA !
De plus, la proposition d’avis de l’EFSA révèle que les effets toxiques du TFA seraient bien plus larges que ce que l’on pensait jusqu’à présent. L’EFSA a récolté pour faire son analyse toutes les données existantes sur le TFA et a notamment obtenu les données les plus récentes de l’industrie auprès de la “TFA task force”, un consortium d’industriels défendant le TFA et regroupant Bayer, BASF, Corteva et Syngenta. Jusqu’à présent, les connaissances sur la toxicité du TFA étaient limitées à ses impacts sur le foie et ses effets reprotoxiques.
L’analyse de ces nouvelles données montre que d’autres organes peuvent être affectés par le TFA.
Les résultats d’une étude réalisée sur 2 générations de rats sont particulièrement préoccupants :
- un impact sur la thyroïde (baisse de l’hormone thyroïdienne T4) a été observé sur les animaux des 2 générations. Selon l’EFSA, “une préoccupation concernant la neurotoxicité développementale (DNT) liée aux TFA ne peut être exclue”, compte tenu de la diminution des taux d’hormones thyroïdiennes observée.
- Une diminution du nombre de leucocytes dans la rate a été observé chez les rongeurs exposés au TFA en période pré et post natal pour toutes les doses testées. Cet effet est un indicateur d’un potentiel effet immunotoxique, effet toxique retrouvé très fréquemment sur d’autres substances PFAS.
- Des modifications dans le sperme ont été retrouvés chez des rats mâles directectement exposés au TFA ou exposés in utéro ou via le lait maternel
Enfin, les données confirment que le TFA traverse la barrière placentaire et des études de biomonitoring réalisées chez l’homme indiquent que du TFA est retrouvé dans le cordon ombilical de nouveaux nés dans 55% des analyses effectuées.
Si ces nouvelles études complètent les connaissances disponibles sur la toxicité du TFA, de nombreuses zones d’ombres persistent. Ces effets préoccupants observés appellent à la réalisation d’études complémentaires, notamment pour évaluer de manière approfondie l’impact du TFA sur la neurotoxicité développementale ou sur le système immunitaire. Et surtout, il manque toujours une étude de toxicité chronique pour évaluer le potentiel cancérigène du TFA.
Pourtant l’EFSA n’estime pas nécessaire de pousser les investigations et minimise certains effets
Malgré ces incertitudes importantes, l’EFSA n’estime pas nécessaire de réaliser une étude de cancérogénicité alors qu’elle reconnaît elle-même que la seul étude chronique disponible, réalisée sur une période de 52 semaines sur des rats exposés via l’eau potable, “ne répond pas aux critères d’une évaluation complète de la cancérogénicité”. L’EFSA ne recommande pas non plus la réalisation d’une étude DNT alors que cet effet “ne peut être exclu” et ne recommande pas d’évaluation complète du potentiel immunotoxique (une seule étude est recommandée pour évaluer cet effet).
De plus, à plusieurs reprises dans son évaluation, l’EFSA minimise les effets qui sont observés dans les études. Ainsi, des modifications dans certains paramètres biologiques (cholestérol, glucose, enzyme hépatique) observées dans plusieurs études ne sont pas considérées comme des effets indésirables. En conséquence, l’EFSA a établi pour plusieurs études, des doses maximales sans effet observé (appelés NOAEL pour No Observed Adverse Effect Level) trop élevées. Pour l’EFSA, parmi toutes les études disponibles, aucun effet néfaste du TFA n’apparaît en dessous de la dose de 8,65 mg/kg de poids corporel/j. Pourtant, plusieurs effets (notamment une augmentation des enzymes hépatiques) ont bien été observés à des doses égales ou inférieures, mais ces effets ne sont tout simplement pas considérés comme adverses par l’EFSA et sont donc ignorés.
Nous dénonçons donc dans notre contribution à la consultation publique ces 2 défaillances dans l’évaluation de l’EFSA : la minimisation de certains effets retrouvés dans les études et la prise en compte insuffisante des incertitudes persistantes. Ces 2 défaillances ont une conséquence importante et grave: la dose journalière admissible pour l’homme proposée par l’EFSA est trop élevée de 0.03 mg/kg/j. En effet, la NOAEL utilisée pour son calcul (8.65 mg/kg/j) est trop élevée et le facteur de sécurité appliqué est insuffisant. En plus du facteur de 100 classiquement utilisé pour prendre en compte les incertitudes liées aux variations inter et intra individuelles, l’EFSA a utilisé un facteur supplémentaire de 3 “pour tenir compte des incertitudes restantes liées à l’absence d’étude de toxicité/cancérogénicité à long terme et à l’absence de test d’immunotoxicité.” Mais ce facteur 3 est très insuffisant. Nous recommandons d’utiliser un facteur de 10, valeur recommandée par l’OMS lorsque des études importantes sont manquantes (2).
La dose journalière admissible proposée par l’EFSA est loin d’être une valeur anodine car elle servira de base aux Etats-Membres pour l’établissement des niveaux qui seront considérés comme “sûrs” dans l’eau potable. A ce jour, la France considère une concentration de TFA dans l’eau potable de 60 µg/L comme sans danger pour la santé. Nous avions déjà dénoncé cette valeur, établie en 2020, sur la base d’hypothèses non réalistes et non protectrices. Les nouvelles données disponibles confirment l’urgence de revoir à la baisse cette valeur.
“En raison de son omniprésence dans l’environnement, le TFA est l’une des substances PFAS auxquelles nous sommes tous le plus exposés, via l’alimentation et l’eau potable. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’avoir la moindre incertitude sur sa toxicité”, déclare Pauline Cervan, pharmacienne et toxicologue chez Générations Futures. “Pourtant, alors que les nouvelles données sur le TFA sont préoccupantes et que le potentiel cancérigène du TFA n’a toujours pas été étudié, l’EFSA minimise ces incertitudes et ne recommande pas de réaliser des études supplémentaires. Pire, l’EFSA propose une dose journalière admissible non protectrice, qui ne tient pas compte du principe de précaution”. Nous appelons l’EFSA a revoir sa position dans son avis final qui devrait être publié en février 2026, afin d’établir une DJA réellement protectrice. La France doit également revoir au plus vite la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L actuellement en vigueur ” conclut-elle.
Fabrique du doute : Comment l’industrie minimise la toxicité du TFA
Un nouveau rapport de PAN Europe, publié le 29 septembre 2025) expose la menace de l’acide trifluoroacétique (TFA), un PFAS ultra-persistant, produit de dégradation de 32 pesticides PFAS approuvés en UE et la manière dont les industriels agissent pour minimiser les impacts de cette substances. Omniprésent dans l’eau potable, les sols et les aliments, le TFA est difficile à éliminer. Des études montrent sa toxicité pour la reproduction (malformations fœtales), ainsi que des effets sur le foie, la thyroïde, le système immunitaire et la qualité du sperme. L’industrie (BASF, Bayer, etc.) minimise ces risques, proposant une limite dans l’eau de 294 μg/L, bien supérieure aux standards protecteurs (2,2–15,6 μg/L). PAN Europe dénonce des décennies de retard réglementaire et appelle à interdire les pesticides PFAS, appliquer le principe de précaution et adopter des normes strictes pour protéger la santé publique, notamment des enfants.
1. Lire notre commentaire à la consultation de l’ECHA et à celle de l’EFSA
2. p21/44: “If minor deficiencies in the data exist with respect to quality, quantity or omission, then an extra factor of 3 or 5 would be appropriate. An extra factor of 10 would be appropriate where major deficiencies in the data exist with respect to quality, quantity or omission, such as a lack of chronic toxicity studies and reproductive toxicity studies”

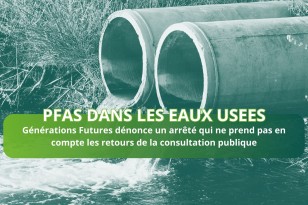
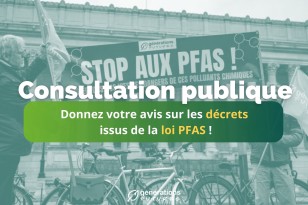

 a besoin de toutes les forces vives pour poursuivre son action
a besoin de toutes les forces vives pour poursuivre son action
